Ah, la question qui pique. Celle qu’on me pose à chaque fois que j’ouvre la bouche en dehors du Grand Est, dès que mon « r » se met à rouler un peu trop ou que je lâche un « ça va, ou bien ? » un peu trop spontané. « Dis donc, t’es Allemand toi, non ? » Soupir. C’est une question simple, en apparence, mais sa réponse est une véritable saga, un mille-feuille d’histoire, de culture et de fierté. Alors, une bonne fois pour toutes, mettons les pieds dans le plat à baeckeoffe.
Non, l’Alsace n’est pas allemande ; les Alsaciens sont des citoyens français dotés d’une identité régionale extrêmement forte, façonnée par des siècles d’une histoire unique entre les mondes germanique et latin.
Voilà. C’est dit. Mais si vous pensez que ça suffit, vous passez à côté de tout le sel de l’histoire. Car pour vraiment comprendre pourquoi un Alsacien se sent Alsacien avant de se sentir Français (et certainement pas Allemand), il faut remonter le temps. Accrochez-vous à votre bretzel, on part en voyage.
Une valse historique à mille temps
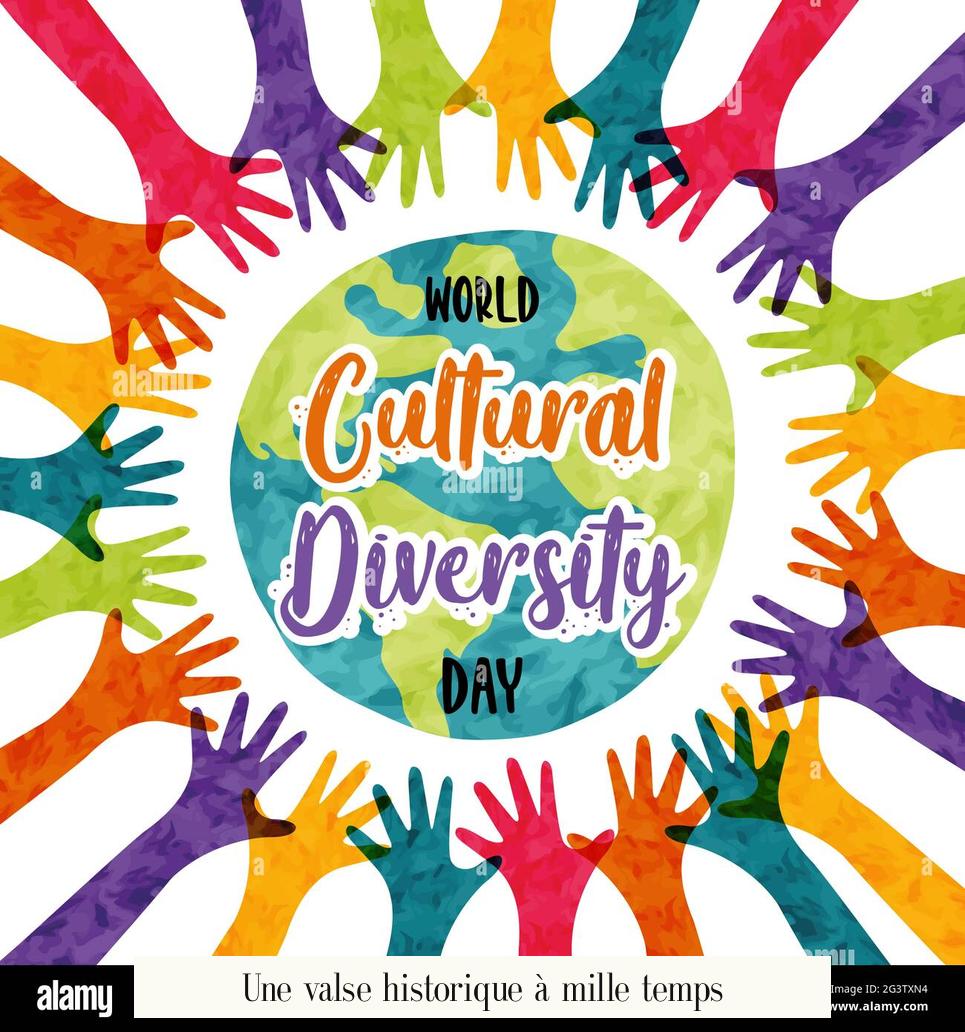
Imaginez un territoire, une plaine fertile blottie entre les Vosges et le Rhin. Un petit bijou que deux grands voisins n’ont eu de cesse de se disputer, comme deux enfants se chamaillant pour le plus beau des jouets. Cette valse-hésitation, c’est l’ADN de notre histoire.
Dès le Moyen Âge, et jusqu’au XVIIe siècle, l’Alsace fait partie du Saint-Empire romain germanique. Nos ancêtres, à cette époque, baragouinaient des dialectes alémaniques et francs. Les noms de nos villages en « -heim » ou « -willer » ne sont pas sortis d’un chapeau, ils sont l’écho de cette longue période germanique. C’est une racine profonde, indéniable. Mais une racine n’est pas l’arbre tout entier.
Puis, en 1648 avec les traités de Westphalie, le Roi-Soleil, Louis XIV, met la main sur ce territoire. Commence alors une longue histoire d’amour, parfois compliquée, avec la France. Pendant plus de deux siècles, l’Alsace s’intègre, s’adapte, tout en gardant ses spécificités. On commence à parler français dans les administrations, mais le dialecte alsacien, l’allemand, restent vivaces dans les foyers et les églises. On est déjà dans cet entre-deux si particulier.
Et patatras. 1870. La défaite française face à la Prusse. L’Alsace (et une partie de la Lorraine) est annexée à l’Empire allemand. Pour nos arrière-grands-parents, c’est un déchirement. Du jour au lendemain, on leur impose la langue de Goethe, l’administration prussienne, le casque à pointe. C’est une période de résistance passive, de « France du cœur ». On se sent Français, mais on vit sous drapeau allemand. Cette dualité schizophrénique va forger un caractère.
En 1918, c’est l’explosion de joie. L’Alsace redevient française ! On acclame les poilus, on sort les drapeaux tricolores cachés dans les greniers. Mais l’euphorie est de courte durée. L’administration française, un peu maladroite, veut « franciser » à marche forcée une population qui a vécu différemment pendant près de 50 ans. On crée des tensions, des incompréhensions.
Puis vient le chapitre le plus sombre. 1940-1945. L’annexion de fait au IIIe Reich. Ce n’est plus l’Empire allemand de 1870, c’est la folie nazie. On impose la nazification, on enrôle de force nos jeunes dans l’armée allemande, les tristement célèbres « Malgré-nous ». Cette période est une blessure béante, une tragédie qui a scellé à tout jamais le refus de l’identité allemande pour la majorité des Alsaciens. C’est le traumatisme ultime qui a définitivement ancré l’Alsace à la France. Depuis 1945, la question ne se pose plus. Nous sommes Français. Point.
L’ADN Alsacien : un cocktail gaulois, romain et germain
Alors, qui sont vraiment nos ancêtres ? La réponse est aussi complexe que notre histoire. On aime souvent simplifier, mais la génétique et l’histoire nous racontent autre chose. Selon les historiens comme Philippe Jacques Fargès-Méricourt, le peuple alsacien est un formidable melting-pot.
Nos racines plongent dans le terreau des tribus gauloises locales. Les Romains sont passés par là, ont laissé des routes, des vignes et un peu de leur sang. Puis, aux IIIe et IVe siècles, les tribus germaniques, les Alamans et les Francs, sont arrivées et se sont installées durablement. Clovis les a unifiés sous la bannière franque. Cet héritage est visible partout.
- Les noms de famille : Meyer, Muller, Schmidt, Klein… Oui, ils sonnent allemand. C’est simplement parce que la francisation a été tardive et n’a jamais cherché à effacer cette culture. On a gardé nos noms, comme on a gardé nos recettes de cuisine.
- Les noms de lieux : Strasbourg (la forteresse des routes), Colmar, Mulhouse… Ils racontent cette histoire germanique. Tenter de les franciser serait une hérésie, un reniement de notre propre histoire.
- La langue : Ah, l’alsacien ! Ce n’est pas de l’allemand mal parlé. C’est un dialecte alémanique, comme ceux parlés en Suisse alémanique ou dans le Bade-Wurtemberg. C’est notre langue de cœur, celle de nos grands-parents. La parler ne fait pas de nous des Allemands, pas plus que parler corse fait d’un Corse un Italien. C’est un trésor culturel qui, malheureusement, se perd un peu.
Ce mélange, c’est notre force. Nous avons la rigueur que l’on prête souvent aux Allemands et l’art de vivre que l’on associe aux Français. Nous sommes le pont, pas le mur.
Plus qu’un accent, une carte de visite chantante
Parlons-en, de cet accent. Celui qui nous trahit dès le premier « bonjour ». Une étude récente de France Bleu a révélé que seuls 8% des Français le trouvent « beau ». Franchement, ça nous fait une belle jambe !
Notre accent, c’est la musique de notre histoire. Chaque « r » qui gratte au fond de la gorge, chaque phrase qui commence par le verbe, c’est l’écho du dialecte qui sommeille en nous. C’est la preuve que notre langue maternelle, ou celle de nos parents, a laissé son empreinte sur notre français.
Le rejeter serait comme demander à un Marseillais d’arrêter de chanter. C’est impossible. Il fait partie de nous. C’est notre label, notre AOC. Quand deux Alsaciens se rencontrent à l’autre bout du monde, ils se reconnaissent en deux secondes à leur accent. C’est un signe de ralliement, une fraternité instantanée. Alors non, il n’est peut-être pas aussi « sexy » que l’accent du Sud, mais il est authentique. Et ça, ça n’a pas de prix.
Le Droit Local : l’exception qui confirme notre règle
Si vous voulez une preuve concrète que l’Alsace n’est pas une région française comme les autres, ne cherchez pas plus loin que notre code civil ou notre calendrier. C’est ce qu’on appelle le « droit local alsacien-mosellan ». Késako ?
C’est un ensemble de lois héritées de la période allemande (1871-1918) que la France a décidé de conserver lors du retour de l’Alsace en 1918. Pourquoi ? Parce qu’elles étaient souvent plus avancées socialement.
| Spécificité du Droit Local | Ce que ça change concrètement |
|---|---|
| Régime de sécurité sociale | Un régime local plus avantageux, avec de meilleurs remboursements. Oui, on est un peu privilégiés, on l’avoue. |
| Le Concordat de 1802 | Chez nous, la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État ne s’applique pas. Les prêtres, pasteurs et rabbins sont rémunérés par l’État. Les églises et temples construits avant 1905 appartiennent aux communes. C’est une organisation unique en France. |
| Jours fériés supplémentaires | Le Vendredi Saint et la Saint-Étienne (26 décembre) sont fériés. Deux jours de plus pour digérer la choucroute, ça ne se refuse pas ! |
| Livre foncier | Un système de publicité foncière différent, tenu par les tribunaux, réputé plus sûr. |
Ce droit local n’est pas un folklore. C’est la démonstration vivante que notre histoire a des conséquences tangibles, quotidiennes, et qu’elle a façonné une société avec ses propres règles. Nous sommes Français, oui, mais avec un astérisque. Un addendum. Une note de bas de page qui dit : « Attention, lire le manuel d’instructions spécifique à l’Alsace ».
Au-delà des clichés : être Alsacien en 2025
Alors, en 2025, ça veut dire quoi être Alsacien ? C’est être bien plus qu’une cigogne sur un toit ou un marché de Noël illuminé.
C’est être profondément Européen. Pour nous, l’Allemagne n’est pas l’étranger. C’est de l’autre côté du pont. On va y faire nos courses, y travailler, s’y balader. Le bilinguisme (français-allemand) est une évidence, une nécessité économique et culturelle. Strasbourg, avec le Parlement européen, incarne cette vocation.
C’est avoir un attachement viscéral à notre région, à nos traditions, sans que cela soit du repli sur soi. On est fier de notre drapeau, le Rot un Wiss (rouge et blanc), de notre gastronomie généreuse, de nos villages fleuris. C’est un patriotisme local qui n’enlève rien à notre citoyenneté française.
C’est aussi, parfois, se sentir un peu incompris par le reste de la France. Non, nous ne mangeons pas de la choucroute tous les jours. Non, nous ne parlons pas tous allemand couramment. Et surtout, non, nous ne sommes pas des Allemands qui s’ignorent.
- Nous sommes Français par choix, par le sang versé, et par l’histoire tragique du XXe siècle.
- Nous sommes de culture rhénane, avec des racines germaniques qui enrichissent notre identité sans la définir entièrement.
- Nous sommes Alsaciens, une synthèse unique de ces deux mondes, une identité à part entière qui ne demande qu’à être comprise.
La prochaine fois que vous croiserez un Alsacien, ne lui demandez pas s’il est Allemand. Demandez-lui plutôt de vous raconter l’histoire de son village, de vous conseiller une bonne winstub, ou de vous apprendre à dire « santé » en alsacien (Gsundheit !). Vous découvrirez alors une richesse et une complexité bien plus savoureuses qu’un simple cliché. Et vous comprendrez que la réponse à la question « Allemande ou Française ? » est finalement la plus belle de toutes : l’Alsace est alsacienne. Et c’est déjà énorme.
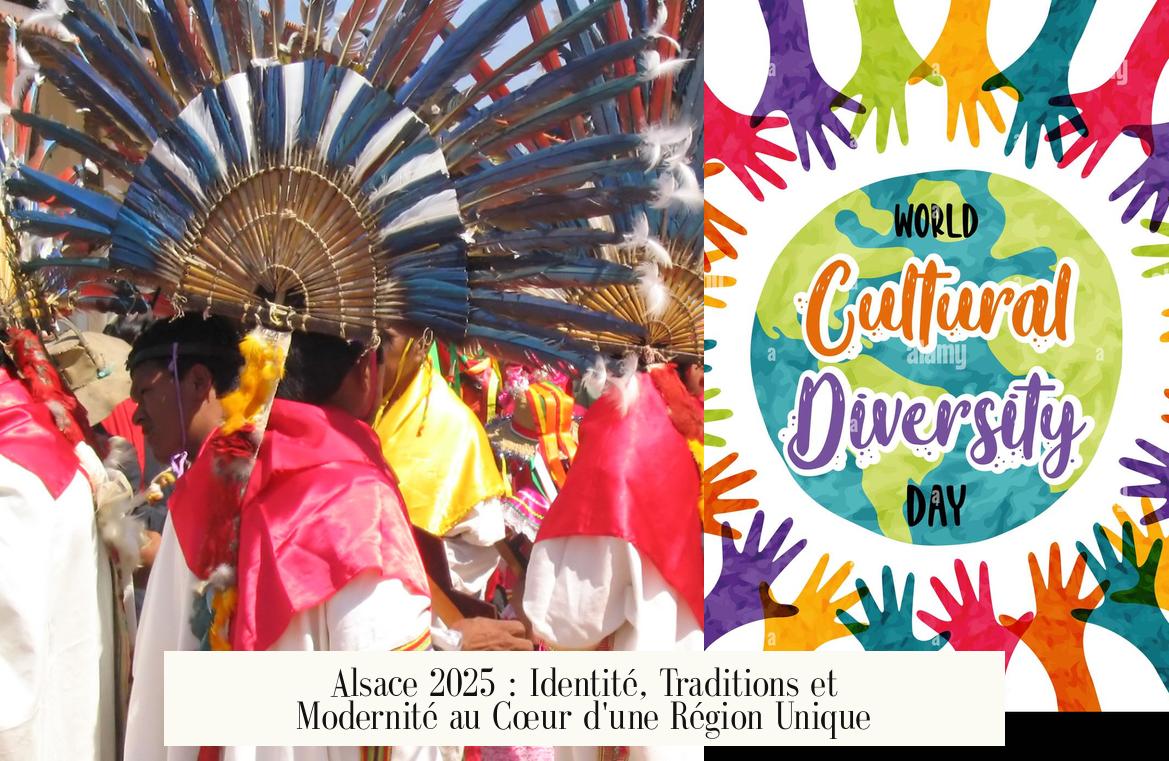
Laisser un commentaire