Nancy. Chaque fois que je déambule sur la place Stanislas, je ressens la même chose. Ce n’est pas juste de l’admiration pour l’architecture, c’est une plongée dans des siècles d’histoire, de stratégies politiques et d’éclats artistiques. On me demande souvent, en voyant la splendeur des lieux, si la ville a un petit nom, un surnom qui encapsule toute cette richesse. La réponse est bien plus complexe et fascinante qu’un simple oui.
Le surnom le plus célèbre de Nancy est la « Ville aux Portes d’Or », mais elle fut aussi affectueusement appelée le « Petit Paris » à la Belle Époque.
Chacun de ces surnoms raconte une histoire différente, une facette unique de l’identité nancéienne. L’un évoque la majesté ducale et la magnificence du XVIIIe siècle, l’autre le bouillonnement intellectuel et industriel d’une ville-refuge devenue capitale de l’Art nouveau. Partons ensemble à la découverte de ces appellations, et même des origines surprenantes du nom « Nancy » lui-même.
La « Ville aux Portes d’Or » : Un Héritage Scintillant du Siècle des Lumières

Impossible de parler de Nancy sans évoquer la place Stanislas. C’est le cœur battant de la cité, un chef-d’œuvre d’équilibre et d’élégance classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Et c’est précisément ici que le surnom de « Ville aux Portes d’Or » prend tout son sens.
Regardez bien. Les grilles qui ferment la place sont de véritables œuvres d’art. Forgées par le maître serrurier Jean Lamour, elles sont rehaussées de feuilles d’or qui scintillent sous le soleil lorrain. Ces portes ne sont pas de simples barrières ; elles sont des dentelles de métal, des volutes rococo qui racontent la gloire de Stanislas Leszczynski, dernier duc de Lorraine et beau-père du roi de France Louis XV.
L’histoire est savoureuse. Stanislas, roi déchu de Pologne, reçoit le duché de Lorraine en viager. Loin de se contenter de gérer les affaires courantes, il se mue en urbaniste visionnaire. Son projet ? Relier la ville médiévale (la Ville Vieille) à la ville neuve (la Ville Neuve, créée par Charles III). Le résultat est cet ensemble architectural unique au monde, composé de la place Stanislas (alors Place Royale, en l’honneur de son gendre), la place de la Carrière et la place d’Alliance.
Les portes dorées de Jean Lamour, avec leurs fontaines majestueuses (Amphitrite et Neptune), ne sont pas qu’un apparat. Elles symbolisent la puissance, le raffinement et le lien indéfectible entre la Lorraine et le royaume de France, symbolisé par les coqs gaulois et les fleurs de lys qui ornent les grilles. Se tenir devant, c’est toucher du doigt l’ambition d’un homme et le génie des artisans du Siècle des Lumières. Ce surnom n’est donc pas une hyperbole, c’est une description littérale de la première chose qui frappe le visiteur ébloui.
Le « Petit Paris » : Quand Nancy Devient le Phare de l’Est
Changeons d’époque et d’ambiance. Si la « Ville aux Portes d’Or » nous plonge dans l’élégance du XVIIIe siècle, le surnom de « Petit Paris » nous catapulte dans une période bien plus tumultueuse et effervescente : la Belle Époque, de 1873 à 1914.
Pour comprendre cette transformation, il faut remonter à la défaite française de 1871. Le traité de Francfort ampute la France de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine (la Moselle actuelle). Nancy, qui reste française, se retrouve soudainement ville-frontière, à quelques kilomètres de l’Empire allemand.
Cette position géographique va radicalement changer son destin. Des milliers d’Alsaciens et de Mosellans, refusant de devenir allemands, affluent vers Nancy. Cet exode massif amène une nouvelle population, mais surtout une nouvelle énergie : des industriels, des artistes, des intellectuels, des universitaires. La ville connaît une explosion démographique et économique sans précédent.
C’est dans ce contexte que naît un mouvement artistique majeur : l’École de Nancy. Portée par des génies comme Émile Gallé (verrier et ébéniste), Louis Majorelle (ébéniste) ou les frères Daum (verriers), cette alliance des arts décoratifs s’inspire de la nature pour créer un art total, l’Art nouveau. Les motifs de feuilles de ginkgo, d’ombelles, de libellules envahissent l’architecture, le mobilier, les vitraux et les objets du quotidien. Nancy devient une capitale culturelle qui rivalise avec Paris. On y trouve une vitalité, une innovation et une concentration de talents qui lui valent ce fameux surnom de « Petit Paris ».
Cette période a laissé une empreinte indélébile sur la ville. En vous promenant, levez les yeux. Vous verrez des façades de la Villa Majorelle, de la Chambre de Commerce et d’Industrie ou de la Brasserie Excelsior qui témoignent de cette splendeur. Ce n’était pas qu’une question d’art ; c’était aussi un acte de résistance culturelle, une manière pour la France de montrer sa vitalité face à son voisin germanique. Le « Petit Paris » n’était pas une imitation, mais une affirmation. Une affirmation que l’on peut encore ressentir en visitant le
Au-delà des Surnoms : L’Origine du Nom « Nancy » Remonte aux Celtes
Après ces épopées grandioses, revenons à la source. Pourquoi la ville de Nancy s’appelle-t-elle Nancy ? L’origine est bien plus humble et terre-à-terre que ses surnoms ne le laissent présager.
Oubliez les ducs et les rois. Remontez bien plus loin dans le temps.
L’explication la plus probable nous vient des Celtes. Le nom « Nancy » dériverait du mot celte « nance », qui signifie… un marais, ou un terrain marécageux. Eh oui. Avant les dorures et l’Art nouveau, le site de Nancy était une zone humide, traversée par le ruisseau de la Méchelle et proche de la rivière Meurthe.
Ça casse un peu le mythe, n’est-ce pas ? Imaginez, la Place Stanislas, ce joyau architectural, érigé sur ce qui fut autrefois un simple marécage. C’est un rappel fascinant que les plus grandes cités naissent souvent de contraintes géographiques. Les premiers habitants se sont installés ici, probablement sur un promontoire légèrement surélevé, un « nanciacum » (le domaine sur le marais), qui a évolué au fil des siècles pour devenir Nancy.
Cette origine toponymique nous raconte une histoire de résilience et d’ingéniosité humaine. Celle de femmes et d’hommes qui ont su dompter un environnement a priori peu favorable pour y bâtir une forteresse, puis une capitale ducale, et enfin la métropole que nous connaissons aujourd’hui. De la boue à l’or, en quelque sorte.
Un Voyage dans le Temps : Les Anciens Noms et Visages de la Cité
L’histoire d’une ville se lit aussi dans les noms qu’elle a portés. Si le nom de la ville elle-même est resté stable, ses lieux emblématiques ont, eux, changé de dénomination au gré des régimes politiques.
Le cas le plus parlant est bien sûr celui de la Place Stanislas. Comme je le mentionnais, sa construction visait à honorer Louis XV. Logiquement, elle fut baptisée « Place Royale » à son inauguration en 1755. Une statue équestre du monarque français trônait en son centre.
Puis vient la Révolution française. Les symboles de la royauté sont abattus. La statue de Louis XV est fondue pour fabriquer des canons, et la place est rebaptisée « Place du Peuple ». Un nom bien plus en phase avec les idéaux de l’époque.
Plus tard, sous Napoléon, elle deviendra la « Place Napoléon ». Ce n’est qu’en 1831, sous la Monarchie de Juillet, que la place trouvera son nom définitif : « Place Stanislas ». Une statue du duc bienfaiteur, conçue par le sculpteur Georges Jacquot, est alors installée sur le piédestal laissé vide, rendant un hommage durable à celui qui a tant offert à la ville. Chaque nom est une strate de l’histoire de France, visible au cœur de Nancy. Pour en savoir plus sur cette histoire, le site de la
ville de Nancy est une mine d’informations.
Et le Prénom, Nancy ? Une Confusion Charmante à Éclaircir
Il y a un dernier point qui sème souvent le trouble. On me demande parfois si le nom de la ville a un rapport avec le prénom féminin Nancy. C’est une question légitime, mais la réponse est non. Il s’agit d’une pure coïncidence onomastique, un hasard de l’histoire des mots.
Pour y voir plus clair, voici un petit tableau récapitulatif :
| Caractéristique | La Ville de Nancy | Le Prénom Nancy |
|---|---|---|
| Origine | Celtique | Hébraïque |
| Mot d’origine | Nance (marais) | Hannah (grâce) |
| Signification | Le lieu marécageux | Gracieuse, pleine de grâce |
| Apparition | Antiquité tardive / Haut Moyen Âge | Diminutif anglais médiéval du prénom Anne |
Le prénom Nancy est en réalité une forme hypocoristique (un diminutif affectueux) du prénom Anne, très populaire dans le monde anglo-saxon avant de se diffuser internationalement. Il n’a donc aucun lien étymologique avec notre cité lorraine.
Cette distinction est importante, car elle souligne à quel point un même mot peut porter des histoires radicalement différentes. La ville de Nancy nous parle de géographie celtique et d’histoire ducale, tandis que le prénom Nancy évoque une tradition biblique et une diffusion culturelle anglo-saxonne.
Alors, la prochaine fois que vous foulerez les pavés de la Place Stan, souvenez-vous de tout cela. Vous ne marchez pas seulement dans une belle ville. Vous êtes au carrefour de plusieurs histoires : celle d’un duc polonais devenu bâtisseur, celle d’artistes qui ont fait fleurir l’Art nouveau sur une terre de refuge, et celle, plus ancienne encore, d’un peuple celte qui a vu un avenir là où il n’y avait qu’un marais.
Nancy, la « Ville aux Portes d’Or », le « Petit Paris »… Peu importe le surnom que vous préférez. Le plus important est de comprendre qu’ils ne sont que des portes d’entrée vers une richesse historique et culturelle qui, elle, est inépuisable.
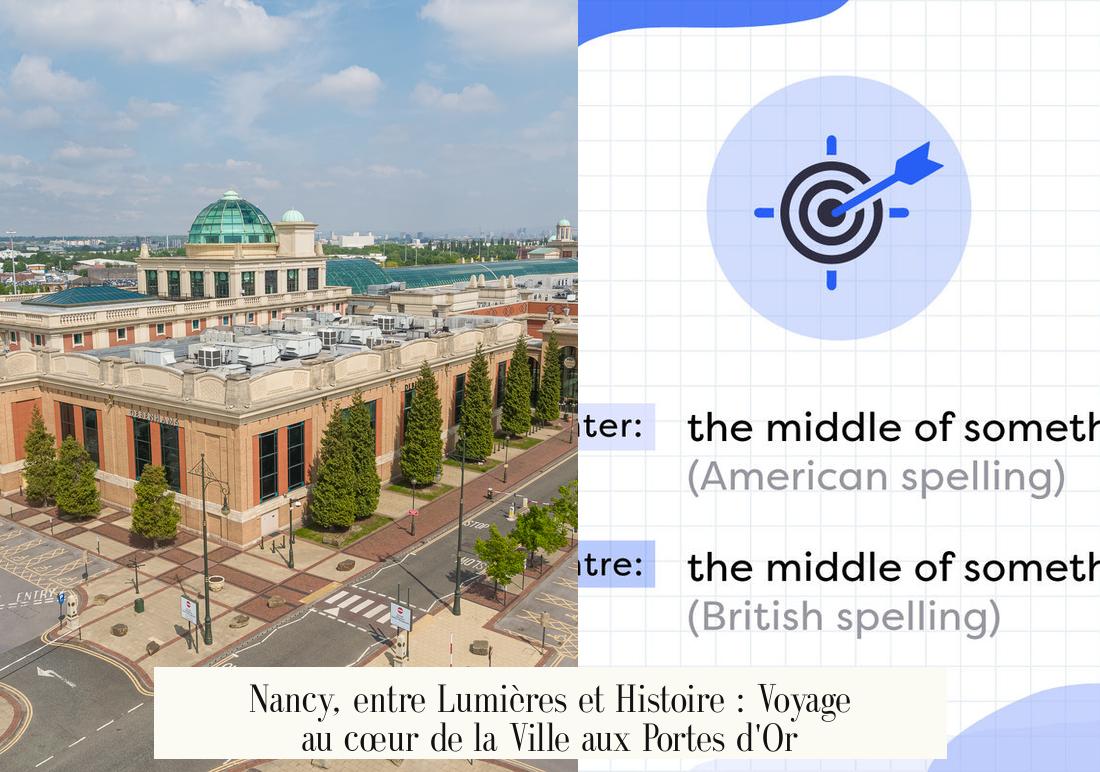
Laisser un commentaire