J’avoue, j’ai une petite manie. Quand je visite une nouvelle ville ou même un petit village paumé, ma première obsession n’est pas de trouver le meilleur café ou le monument incontournable. Non. Ma première question, celle qui me taraude, c’est : « Mais comment on les appelle, les gens d’ici ? ». C’est plus fort que moi. Cette quête du nom d’habitant, ce petit mot parfois poétique, parfois franchement bizarre, est devenue une véritable passion.
Alors, si comme moi vous vous êtes déjà demandé comment diable on a pu passer de « Château-Thierry » à « Castelthéodoricien », vous êtes au bon endroit. On va plonger ensemble dans le monde fascinant des gentilés.
Un gentilé, ou son synonyme plus formel le démonyme, est tout simplement le nom que l’on donne aux habitants d’un lieu spécifique.
Que ce soit une ville, une région, un pays, un continent ou même, comme on le verra, une autre planète.
C’est le mot qui transforme une simple coordonnée géographique en une identité.
Gentilé, Démonyme, et le Faux Ami : le Gentilice

Commençons par mettre les choses au clair. Dans la vie de tous les jours, vous entendrez surtout le mot « gentilé ». C’est le terme le plus courant. Son cousin, « démonyme », est un peu plus savant, tiré du grec dêmos (le peuple) et ónoma (le nom). Pour 99 % des conversations, ils sont interchangeables. Je préfère personnellement « gentilé », il a une sonorité plus douce, moins… démoniaque.
Mais attention au piège ! Il existe un troisième larron, un mot qui ressemble étrangement mais qui n’a rien à voir : le gentilice.
C’est un véritable faux ami, une peau de banane linguistique. Le gentilice nous vient tout droit de la Rome antique. Il ne désignait pas l’habitant d’un lieu, mais le nom d’une gens, c’est-à-dire un grand groupe de familles ou un clan qui se réclamait d’un ancêtre commun. Par exemple, dans Gaius Julius Caesar (Jules César), « Julius » est le gentilice. Il indique son appartenance à la gens Iulia.
Alors, la prochaine fois que vous voudrez briller en société, vous saurez faire la différence :
* Romain : le gentilé pour un habitant de Rome.
* Julius : le gentilice d’un membre de la famille Julia.
Subtil, n’est-ce pas ? Cette distinction faite, revenons à nos chers habitants.
La Grande Fabrique des Gentilés : une Science (pas si) Exacte
Comment naît un gentilé ? C’est un mélange fascinant de linguistique, d’histoire et parfois, d’une bonne dose de fantaisie. Il n’y a pas de règle absolue, ce qui explique pourquoi on se retrouve avec des pépites aussi inattendues. Mais il y a quand même de grandes tendances.
La méthode la plus courante est d’ajouter un suffixe au nom du lieu. Et là, c’est la fête du suffixe.
Les Suffixes Stars
Il y a les grands classiques, les têtes d’affiche que l’on retrouve partout :
- -ais / -aise : Le plus répandu, le plus simple. Paris donne Parisiens, Lyon donne Lyonnais, Londres donne Londoniens. C’est le suffixe passe-partout, le jean de la garde-robe des gentilés.
- -ien / -ienne : Très populaire aussi, souvent pour les pays ou les continents. Italie -> Italiens, Europe -> Européens. Il a une petite touche d’élégance, je trouve.
- -ois / -oise : Un grand classique, souvent issu du bas latin. Il sent bon le terroir. Chartres donne Chartrains, mais Blois donne Blésois. On sent déjà que les choses se compliquent.
- -ain / -aine : Plus rare, mais très chic. Rome nous offre les Romains et les Romaines. C’est un suffixe qui a de la bouteille.
Les Outsiders et les Formes Savantes
Et puis, il y a les autres. Ceux qui aiment se faire remarquer. Les formes qui ne ressemblent en rien au nom de la ville. C’est là que le voyage devient vraiment intéressant. Ces formes, dites « savantes », puisent souvent leurs racines dans le nom latin, grec ou médiéval du lieu.
C’est une façon de se reconnecter à une histoire plus ancienne, de porter un nom qui a traversé les siècles.
Prenons l’exemple du département du Rhône. Le fleuve, Rhodanus en latin, a donné son nom aux habitants : les Rhodaniens et Rhodaniennes. Ça sonne tout de suite plus majestueux que « Rhônais », non ? On sent le poids de l’histoire gallo-romaine derrière ce simple mot.
C’est le même principe pour des villes comme :
* Saint-Lô (Manche) : les Laudois (du nom médiéval Laudus).
* Châlons-en-Champagne (Marne) : les Châlonnais (simple), mais aussi les Catalaunes, en référence à la bataille des Champs Catalauniques.
* Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) : les Réginaburgiens. Littéralement, une traduction latiniste de « Bourg de la Reine ». Il fallait oser.
Ces gentilés sont des capsules temporelles. Ils nous racontent une histoire que le nom moderne de la ville a parfois oubliée.
Le Temple de la Bizarrerie : Mon Top des Gentilés Insolites
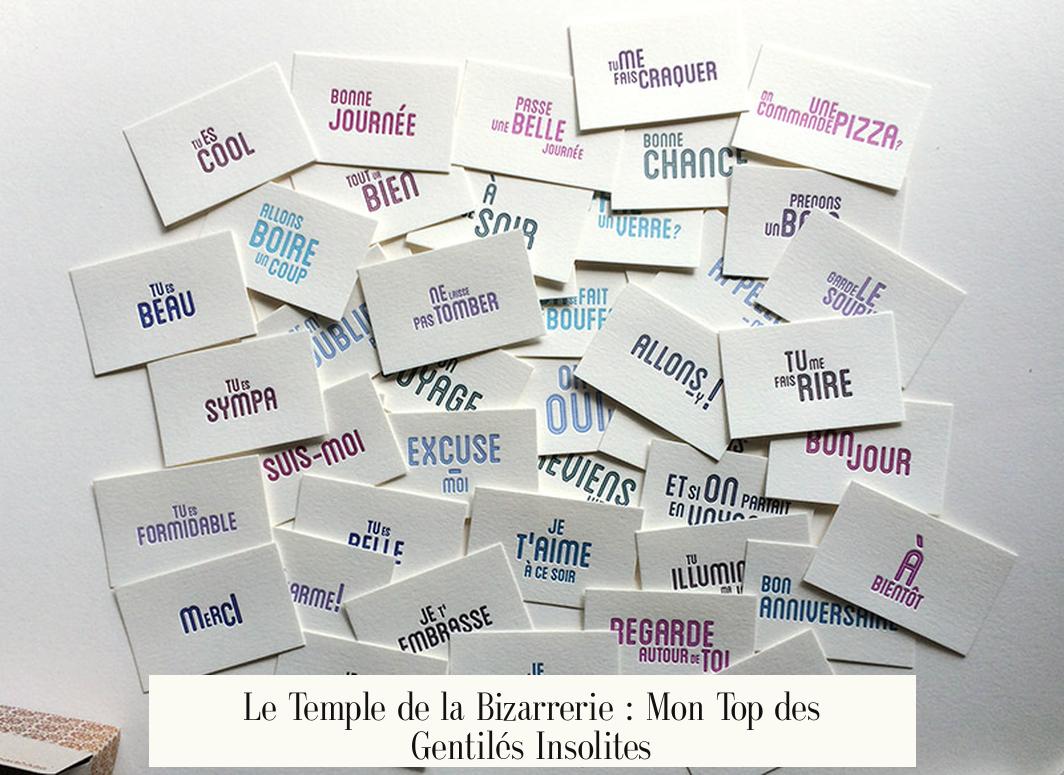
J’ai une collection personnelle de gentilés étranges. Ce sont mes petits trésors, ceux qui me font sourire à chaque fois que je les entends. Permettez-moi de partager quelques-uns de mes préférés.
« Appeler les habitants de Y « Ypsiloniens » est une preuve que la langue française a un sens de l’humour absolument délicieux. C’est un trait d’esprit géographique. »
Ce n’est pas juste une liste, c’est un voyage au cœur de la créativité linguistique française.
| Ville (Département) | Gentilé | Le petit secret derrière le nom |
|---|---|---|
| Y (Somme) | Ypsiloniens | Parce que la lettre « Y » se dit « upsilon » en grec. C’est la plus petite commune de France par le nom, mais l’une des plus grandes par l’ingéniosité ! |
| Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) | Luziens | Simple, efficace, mais un peu déroutant au début. On oublie complètement le « Saint-Jean ». |
| Foix (Ariège) | Fuxéens |
Issu de Fuxum, le nom latin du château. Un « x » qui sort de nulle part, pour le plus grand plaisir des cruciverbistes. |
| Le Mans (Sarthe) | Manceaux / Mancelles |
Une forme irrégulière qui vient des Aulerques Cénomans, le peuple gaulois qui habitait la région. Un pur concentré d’histoire. |
| Eu (Seine-Maritime) | Eudois | Simple, mais quand on demande « Vous êtes d’où ? », la réponse « Je suis Eudois » peut créer des dialogues assez comiques. |
Chacun de ces noms est une porte d’entrée vers une anecdote, une histoire locale. Ils prouvent que la langue n’est pas qu’un outil de communication, c’est aussi un terrain de jeu.
Objectif Mars : Les Gentilés de l’Espace et d’Ailleurs
Notre exploration ne s’arrête pas aux frontières de l’Hexagone, ni même de la Terre. La question se pose : comment appeler les habitants des autres planètes ?
La science-fiction s’est emparée du sujet depuis longtemps, et la langue française a suivi. Pour les habitants (hypothétiques, bien sûr) de la planète Mars, le gentilé est Marsien ou Marsienne. C’est logique, direct, et ça nous vient tout droit de l’imaginaire collectif.
Mais là où ça devient drôle, c’est que la réalité terrestre rattrape la fiction interplanétaire. En France, il existe plusieurs communes nommées « Mars ». Il y a Mars dans le Gard, Petit-Mars et Saint-Mars-du-Désert en Loire-Atlantique… Et devinez quoi ? Leurs habitants sont aussi appelés des… Marsiens !
Imaginez la scène en 2025 : « Je suis un Marsien ». La première réaction ne sera plus « Oh, un extraterrestre ! », mais « Ah, du Gard ou de la Loire-Atlantique ? ». C’est un excellent rappel que nos pieds sont, pour l’instant, bien ancrés sur notre propre planète.
Et pour les autres ?
- Les habitants de la Lune sont les Sélénites (de Séléné, déesse grecque de la Lune) ou plus simplement les Luniens.
- Ceux de Vénus sont les Vénusiens.
- Ceux de Jupiter sont les Joviens.
Ces noms, pour l’instant théoriques, montrent la formidable capacité de la langue à nommer l’inconnu, à projeter notre système de pensée bien au-delà de notre atmosphère.
Plus qu’un Mot, une Identité
On pourrait croire qu’un gentilé n’est qu’une étiquette administrative, un mot pratique pour les formulaires. Mais c’est tellement plus que ça. C’est un marqueur d’appartenance, parfois même une source de fierté immense.
Pensez aux Ch’tis dans le Nord, un gentilé populaire devenu un symbole culturel. Ou aux Corses, dont le nom évoque toute une île, une culture, une histoire forte. Le gentilé nous rattache à un lieu, à une communauté. Il dit « je viens d’ici » avec une précision et une charge émotionnelle que « j’habite à… » ne pourra jamais avoir.
Parfois, cette identité est si forte que des débats naissent. Certaines communes n’ont pas de gentilé officiel. Leurs habitants utilisent des noms différents, se disputent sur la forme la plus légitime. Ces « guerres de clocher linguistiques » sont la preuve que ces mots sont vivants, qu’ils comptent pour les gens. Ils ne sont pas figés dans le marbre par une académie ; ils naissent et vivent au gré de l’usage et de l’attachement des habitants à leur terre. Vous pouvez retrouver de nombreuses listes sur des sites comme
Wikipédia, qui sont souvent le fruit de recherches passionnées.
Le Guide du Détective de Gentilés
Vous êtes maintenant prêt à partir à la chasse aux gentilés. Mais comment faire quand on est face à une ville inconnue et qu’on veut absolument savoir ? Voici ma méthode personnelle, en quelques étapes.
- La voie royale : la recherche en ligne. C’est la méthode la plus simple. Tapez « gentilé + [nom de la ville] » dans un moteur de recherche. En général, la réponse est immédiate. Les mairies et les pages Wikipédia des communes sont vos meilleures amies.
- L’analyse des suffixes. Si vous voulez jouer, essayez de deviner. Le nom de la ville se termine par -ville ? Il y a de fortes chances que le suffixe soit -ois (Abbeville -> Abbevillois). La ville a un nom à consonance latine ? Cherchez un gentilé savant. C’est un excellent exercice de déduction.
- Pensez à l’histoire. Si le nom simple ne fonctionne pas, remontez le temps. Quel était l’ancien nom de la ville ? Le nom du peuple gaulois qui y vivait ? C’est souvent là que se cache la clé des gentilés les plus surprenants.
- La botte secrète : demandez à un local ! C’est la méthode la plus sympathique. Non seulement vous aurez la bonne réponse, mais vous engagerez probablement une conversation passionnante sur l’histoire de leur ville. Les gens sont souvent fiers de leur gentilé, surtout s’il est original.
- En cas de doute absolu… Ne prenez pas de risque. Dites simplement « les habitants de [nom de la ville] ». C’est moins élégant, mais ça vous évitera de commettre un impair et d’appeler un Fuxéen un « Foixois », ce qui pourrait être très mal pris !
Au fond, les gentilés sont bien plus qu’une simple curiosité linguistique. Ils sont le reflet de notre histoire, de notre géographie, de notre culture et même de notre humour. Ils sont la preuve que derrière chaque point sur une carte, il y a des gens, une identité, une histoire à raconter.
Alors la prochaine fois que vous croiserez un Castelthéodoricien, un Rhodanien ou, qui sait, un Marsien, vous saurez que leur nom n’est pas anodin. C’est un petit morceau de patrimoine qu’ils transportent avec eux.
Et vous, quel est le gentilé le plus fou que vous ayez jamais entendu ? La chasse est ouverte.

Laisser un commentaire